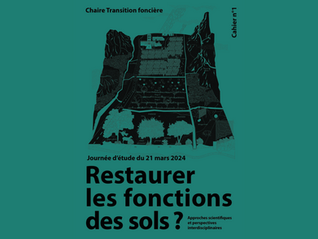La directive sur la surveillance et la résilience des sols : historique d'une mise à l'agenda et états des lieux de la préservation des sols au niveau européen
- Institut de la Transition Foncière

- 13 mai
- 14 min de lecture
Dernière mise à jour : 13 oct.
Entre 60 % et 70 % des sols de l’Union européenne sont aujourd’hui en mauvaise santé.
Le 5 juillet 2023, la Commission européenne a présenté une proposition visant à instaurer un cadre cohérent de surveillance pour les sols de l’Union européenne.
La directive fixe comme objectif d’atteindre des sols sains d’ici 2050 en : - mettant en place un cadre de surveillance et d’évaluation cohérent pour tous les sols dans l’ensemble de l’UE afin que les États membres puissent prendre des mesures pour régénérer les sols dégradés. - demandant aux États membres d’identifier les sites potentiellement contaminés, d’enquêter sur ces sites afin de d’adresser les risques pour la santé humaine et l’environnement.
L’accord provisoire du trilogue du 10 avril 2025 constitue un avancement vers la protection des sols au niveau européen, mettant en place un premier cadre légal commun.
Toutefois, une grande flexibilité est accordée aux Etats dans la mise en œuvre de la directive et le texte ne comporte pas d’obligations liées à la gestion durable des sols.
L’Institut rappelle ainsi la nécessité d’une transposition ambitieuse et rapide à l’échelle des Etats-membres afin d’assurer la faisabilité opérationnelle de la mise en œuvre de l'objectif d’atteinte de sols sains en 2050.
Le 5 juillet 2023, la Commission européenne a présenté une proposition visant à instaurer un cadre solide et cohérent pour des sols européens en bonne santé d’ici 2050, afin de combler les lacunes réglementaires.
Après la modification et l’adoption en première lecture du texte de la Commission par le Parlement européen, le 10 avril 2024 [1], et le Conseil [2], le 17 juin 2024, les négociations du trilogue ont abouti le jeudi 10 avril 2025 à un "accord en deuxième lecture anticipée". Le Conseil devrait à présent adopter formellement l'accord, qui pourra ensuite être approuvé par le Parlement en deuxième lecture. La directive entrera ensuite en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne (UE), à la suite de quoi les Etats membres auront trois ans pour transposer les dispositions du texte.
Le texte s’articule autour de quatre axes principaux :
Le chapitre I, relatif aux dispositions générales : fixe la mise en place d’un cadre commun de surveillance et d'évaluation de l'état des sols, de gestion durable des sols et des sites contaminés ;
Le chapitre II relatif à la mise en œuvre d’un cadre de surveillance et d’évaluation de la santé des sols : les États-membres mettent en place ce cadre, fondé sur des districts de gestion des sols [3] définis par les États membres, appelés “soils districts”. Il repose sur plusieurs éléments tels que des descripteurs physiques, chimiques et biologiques des sols, des critères de santé, d’occupation et d’imperméabilisation des sols, des modalités de prélèvements d’échantillons - dont les détails figure en annexe de la directive - ainsi que la création d’un portail numérique sur la santé des sols ;
Le chapitre III relatif à la gestion durable des sols ;
Le chapitre IV relatif aux sites contaminés : les États membres sont tenus d'adopter une approche fondée sur les risques, en ayant l’obligation de lister les sites contaminés et potentiellement contaminés ;
Finalement, les derniers chapitres concernent le financement, l’information du public et les rapports des Etats membres, ainsi que l’accès à la justice, les sanctions des Etats-membres et la transposition de la directive.
Une mise à l'agenda progressive de la protection des sols au niveau européen
Un mouvement de préservation des sols est initié au niveau européen en 1972 avec la Charte européenne pour les sols. Celle-ci reconnaît notamment les sols comme un “milieu complexe et dynamique” et souligne leur rôle essentiel dans la régulation du cycle de l'eau et de la préservation de la biodiversité, tout en alertant sur leur “dégradation biologique croissante”. Elle invite aussi les États membres à adopter des politiques de conservation de leurs sols. Confrontée à l'absence de compétence explicite de l'Union européenne en matière d'aménagement du territoire, la portée de la charte est toutefois limitée.
Les années 2000 marquent un tournant avec la révision de la Charte européenne des sols en 2003 qui introduit le concept de "gestion durable des sols". Dans cette lignée, la Commission européenne propose en 2006 un projet de directive-cadre sur les sols, afin d’établir un cadre législatif commun. Il prévoit la création d’un inventaire des sites pollués, l'évaluation des impacts des politiques sectorielles sur les sols et l'amélioration des connaissances sur ces derniers. Néanmoins, le texte se heurte à l'opposition de cinq pays membres, dont la France, qui plaident pour des réglementations à l’échelle nationale, l'empêchant de voir le jour. En 2011, l’inscription de l'objectif "zéro artificialisation nette" à l’horizon 2050 (no net land take by 2050) dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources marque toutefois la volonté européenne persistante de parvenir à une meilleure protection des sols. Cet objectif n’est cependant qu’une simple ligne directrice, dénuée de tout caractère contraignant pour les États membres.
En 2020, la Commission européenne remet le sujet de la protection des sols sur le métier, en publiant la Stratégie pour la protection des sols à l’horizon 2030, qui s’inscrit dans les objectifs du Pacte vert pour l’Europe lancé en 2019. Elle fixe des orientations stratégiques, notamment en incitant à l’intégration d’une “hiérarchie de l’artificialisation des terres” dans les plans d’écologisation de l’espace urbain [4], en priorisant la réutilisation et le recyclage des terres et la qualité des sols urbains. Elle invite aussi les Etats membres à supprimer progressivement les incitations financières à l’artificialisation. Cette stratégie, qui vise à garantir des sols en bonne santé dans l’Union d’ici 2050 (voir encadré), annonce également l’intention de la Commission européenne de présenter un nouveau cadre législatif pour les sols, afin de lutter efficacement contre leur dégradation en assurant une cohérence des politiques nationales et européennes. En introduisant la notion de "santé des sols", la Stratégie ouvre ainsi la voie à une reconnaissance du sol comme entité vivante, remettant en question l’approche anthropocentrée qui prévalait jusqu'alors (Naudin, 2023). Ainsi, le 5 juillet 2023, la Commission européenne a présenté une proposition de directive sur la surveillance et la résilience des sols (soil monitoring law) dont l’objectif à long terme est de parvenir à des sols sains d’ici 2050.
Introduction de la notion de “santé de sols” dans la Stratégie pour la protection des sols[5] “Un sol sain est un sol en bonne santé chimique, biologique et physique et qui est par conséquent à même de fournir en permanence le plus grand nombre possible de ces services écosystémiques:
|
Un besoin urgent d'un cadre réglementaire harmonisé et d'objectifs contraignants pour la préservation des sols
Jusqu’à présent, et malgré les tentatives susmentionnées, l’UE ne disposait d’aucun cadre législatif harmonisé relatif à la protection des sols, contribuant à leur état alarmant : entre 60 % et 70 % des sols de l’Union européenne sont aujourd’hui en mauvaise santé. De surcroît, les États membres utilisent différents indicateurs, méthodes d’échantillonnage et d’analyse, ce qui entraîne une incohérence et un manque de comparabilité des données des sols de l’Union européenne. Or, comme le souligne la Commission dans son projet de directive, la dégradation des sols dépasse largement les frontières nationales et l’inaction des Etats entraîne des répercussions sur d’autres Etats voisins [6]. Cette carence réglementaire a été soulignée par plusieurs acteurs et institutions européennes, notamment le Parlement européen [7], la Cour des comptes européenne [8], le Comité des régions [9] et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) [10].
La directive affirme surtout une reconnaissance des sols comme ressource à préserver. La Commission européenne rappelle ainsi que “les sols constituent une ressource vitale, limitée, non renouvelable et irremplaçable” [11] , essentielle aux équilibres écologiques et économiques de l’Union. Les sols jouent un rôle majeur dans les cycles des nutriments, du carbone et de l’eau – des processus dépassant les frontières nationales. Son lien avec la sécurité alimentaire a été remis au centre de la table avec la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine qui a renforcé la nécessité pour l’Union européenne d’assurer la durabilité des systèmes alimentaires européens. Comme l’indique la Commission européenne : “Les sols fertiles revêtent une importance géostratégique car ils nous garantissent l’accès à des denrées alimentaires en quantité suffisante, nutritives et abordables à long terme”. En effet, 95% de notre alimentation dépend des sols (au niveau mondial), alors que, selon les estimations, entre 61% et 73% des sols agricoles de l’Union sont touchés par l’érosion, la perte de carbone organique, les excès de nutriments, le compactage,... et que les catastrophes environnementales ne cessent de se multiplier, portant davantage atteinte encore aux rendements agricoles sur le territoire européen.
Les ambitions initiales du projet de directive de la Commission européenne : mettre en place un cadre cohérent de surveillance et de préservation des sols de l'Union européenne
Pour toutes ces raisons et afin de garantir des sols sains d’ici 2050, la proposition de directive par la Commission européenne vise à mettre en place un cadre cohérent de surveillance pour les sols de l’Union. Son objectif est double : assurer une évaluation rigoureuse de l’état des sols et fournir une base scientifique pour orienter les politiques publiques et les pratiques de gestion durable des sols. Il s’agirait d’un système de surveillance intégré, harmonisé, basé sur les données de l’Union, des Etats membres et du secteur privé. Cette connaissance renforcée de la santé des sols permettrait une meilleure gestion et un cadre plus efficace en termes d’adaptation et d’atténuation du changement climatique.
La gestion durable des sols n’ayant pas encore de modèle économique viable, le projet de directive de la Commission européenne prévoit des mécanismes de soutien financier aux acteurs concernés. Elle encourage une mobilisation coordonnée des financements publics et privés afin de faciliter l’adoption de pratiques durables. L’Union européenne souhaite inciter les États membres à affecter des fonds nationaux à la gestion durable des sols, tout en investissant ses propres instruments financiers. En parallèle, la directive ambitionne de mobiliser les investisseurs privés et les filières économiques connexes afin d’élaborer un modèle de financement pérenne.
S’inscrivant dans le cadre de la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement (article 191 du TFUE), la directive repose sur un principe de compétence partagée entre l’Union et les États membres. À ce titre, la directive doit respecter le principe de subsidiarité et laisse ainsi aux Etats membres une marge de manœuvre assez large quant à l’adaptation des mesures aux réalités locales et régionales et prévoit de leur laisser de la flexibilité dans la mise en place d’une gouvernance efficace, tout comme pour le choix des mécanismes de surveillance et d’évaluation de la santé des sols adaptés afin de parvenir à un bon état de santé des sols dans l’ensemble de l’Union d’ici 2050.
Un accord de trilogue en demi-teinte : la mise en place d'un cadre légal européen pour les sols, qui reste peu contraignant pour les Etats-membres
Après avoir été examinée par le Parlement européen et le Conseil, la proposition de la Commission européenne a été ensuite négociée en trilogue. Ces négociations ont ainsi abouti le jeudi 10 avril à un accord provisoire. Si texte final n’a pas encore été publié à ce jour (09/05/2025), nous pouvons d’ores et déjà tirer des communications officielles du Parlement européen [12] et du Conseil [13] des premières analyses. Sur cette base, cet accord semble constituer un premier avancement vers la protection des sols au niveau européen, mettant en place un premier cadre légal commun. Toutefois, son contenu apparaît peu contraignant pour les Etats membres.
A. La mise en place d’un cadre de surveillance et d’évaluation des sols
Le texte entérine plusieurs obligations en termes de surveillance et d’évaluation des sols. Les Etats-membres devront ainsi évaluer la santé de leurs sols en se basant sur des critères communs (“descripteurs de sols” dans la directive, déterminés en annexe) - qui correspondent à des paramètres physiques, chimiques et biologiques des sols - ainsi qu’en s’appuyant sur une méthodologie commune, en annexe de la directive, pour les points de prélèvements. A cet égard, ils pourront s’appuyer sur leurs programmes nationaux ou d’autres méthodes équivalentes. En parallèle, le programme d'échantillonnage LUCAS Soils, sera renforcé, pour apporter un soutien financier et technique.
Par ailleurs, la directive met en place deux types d’objectifs pour chaque descripteur de sols : des “valeurs cibles durables”, objectifs de long terme non contraignants, fixés au niveau européen, ainsi que des “valeurs de déclenchement opérationnelles”, définies au niveau national, afin de prioriser et mettre en oeuvre progressivement les actions visant à restaurer la santé des sols.
La directive vient ensuite fixer des principes d’atténuation de l’artificialisation des sols en ce qui concerne l’imperméabilisation et l’enlèvement des sols, qui devront être pris en compte par les Etats membres en parallèle de leur réglementation nationale.
B. La mise en place d’une approche par les risques concernant les sites pollués
Finalement, les Etats européens devront se tenir à plusieurs obligations concernant les sites pollués, en adoptant une approche par les risques . Ils devront établir – 18 mois après l’entrée en vigueur du texte – une liste de substances émergentes indicatives pouvant constituer un risque pour la santé humaine ou l’environnement, incluant entre autres les pesticides et les PFASS. Ils devront également établir une liste des sites potentiellement contaminés dans les 10 ans suivant l’entrée en vigueur du texte et adresser « tout risque inacceptable pour la santé et l’environnement ».
C. Malgré les ambitions affichées, le caractère non contraignant de la plupart des mesures a été maintenu à l'issue du trilogue:
C’est ainsi le cas de l'objectif clé de la directive, visant à atteindre des sols sains en 2050, mais également, des objectifs que doivent fixer les Etats-membres pour chaque descripteurs de sols visant à améliorer la qualité des sols. Par ailleurs, les obligations concernant l’identification et la mise en œuvre des pratiques de gestion durable des sols, et les principes communs de gestion des sols, initialement présents dans la proposition de la Commission, ont été supprimés dans l’accord. Le même constat est ainsi notable pour les mesures d’atténuation de l’artificialisation, restant à l’état de mesures volontaires et dont le champ d’application a été réduit à l'imperméabilisation et à l’enlèvement des sols.
En conclusion, si ce texte de directive constitue un jalon important vers la préservation des sols à l’échelle européenne et affiche un objectif ambitieux en 2050, l’absence de contraintes pour les Etats ne doit pas freiner sa mise en œuvre opérationnelle et effective. La France, comme elle le fut sur l’objectif ZAN, peut conserver sa place de leader européen sur les sols à travers une transposition ambitieuse à l’échelle nationale afin d’assurer, à travers la connaissance des sols, la faisabilité de l'objectif d’atteinte de sols sains en 2050. Il faut dès lors s'atteler à une mise en œuvre de la récupération de la donnée. A cet égard, l’Institut de la Transition foncière plaide pour la mise en place d’un diagnostic des quatre fonctions écologiques des sols au moment de la vente. Malgré des travaux pionniers en France du GIS-Sol, les données actuelles sont limitées par leur échelle (1/250000e, carreaux de 16km), leur temporalité de mise à jour, et leur périmètre (peu de données sur les sols en milieux urbains). Un tel diagnostic permettrait ainsi de disposer d’une information harmonisée et régulièrement mise à jour sur l’état des sols à l’échelle de chaque parcelle, et permettrait donc un meilleur pilotage des politiques publiques en faveur de la préservation des sols. Une étude de l’Institut évalue actuellement la faisabilité financière, réglementaire, et technique d’un tel diagnostic.
ANNEXE - POSITIONS RESPECTIVES DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE : ENTRE PRÉCISIONS DES MESURES ET ASSOUPLISSEMENTS DES CONTRAINTES
Présentée en juillet 2023 par la Commission européenne, la proposition de directive a ensuite été examinée par le Parlement européen et le Conseil : adopté en première lecture par les deux institutions – le 10 avril 2024 par Parlement européen [14] et le 17 juin 2024 par le Conseil [15].
1- Texte voté au Parlement européen
Le texte voté par le Parlement propose quelques améliorations par rapport à la version initiale de la Commission:
Introduction d’une catégorisation de l’état écologique des sols en cinq niveaux : état écologique élevé, bon, modéré, dégradé et gravement dégradé.
Précision sur la liste de contaminants des sols à surveiller (non obligatoire) avec les produits phytopharmaceutiques candidats à la substitution et substances autorisées en régime d’urgence, et résidus de biocides, ainsi que les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).
Introduction d’une cartographie des friches industrielles et des sites abandonnés.
Incitation à renforcer la participation publique pour les sites contaminés.
Toutefois, le Parlement diminue l’ambition de préservation des sols porté par le projet de directive de la Commission :
Suppression du calendrier contraignant proposé dans le rapport de la commission ENVI [16], qui définissait une trajectoire progressive pour l’amélioration des sols à partir des cinq catégories énoncées précédemment.
Assouplissement de la définition des sols proposée par la Commission en excluant les gisements de matières premières.
Moindre exigence en matière de surveillance et d’évaluation de l’état des sols, en permettant aux États membres de sélectionner les descripteurs qu’ils jugent les plus pertinents selon leurs spécificités nationales.
Suppression de l'obligation pour les États membres de définir les pratiques de gestion durables des sols, se limitant à une évaluation régulière de l’efficacité des mesures mises en place ; la liste initialement proposée par la Commission de principes de gestion durable des sols a ainsi été abandonnée.
Les dispositions relatives aux sanctions ont été retirées du texte.
Abandon d’un objectif intermédiaire vers l’atteinte d’un état de sols sains en 2050.
2- Texte adopté par le Conseil
Le Conseil quant à lui propose quelques enrichissements :
Amplification de la liste des descripteurs de biodiversité des sols, parmi lesquels les pays devront choisir au moins un indicateur à surveiller.
Introduction d’une liste de surveillance des contaminants du sols qui vise à identifier les substances susceptibles d’avoir un impact significatif sur la santé des sols, la santé humaine ou l’environnement.
Contrairement au Parlement européen, le Conseil réintroduit la possibilité d’inclure des principes directeurs de gestion durable des sols dans le texte final, tout en laissant aux Etats membres le soin de définir et de mettre en œuvre des pratiques adaptées.
Maintien de l'article sur l’accès à la justice pour s’assurer que la législation européenne soit respectée, bien que sous une forme affaiblie, supprimant les dispositions prévoyant des sanctions.
Et plusieurs assouplissements :
La santé des sols est surveillée à l’échelle de l’unité de sol, tandis que l’artificialisation et la destruction des sols seront suivies au niveau du district.
Les descripteurs des sols pourraient être entièrement définis par les pays eux-mêmes.
Le sujet de l’information et de la participation du public a aussi été revu à la baisse.
Les délais de transposition, de suivi et d’évaluation ont été légèrement décalés, compromettant les résultats souhaités.
Éloignement de la notion d’ “artificialisation des sols” en se concentrant sur “ l’imperméabilisation et enlèvement des sols” pour donner la priorité à l’aspect de l’artificialisation “le plus visible, le plus impactant et le plus facile à surveiller de l’occupation des sols”.
Image de couverture : The 1:5 Million International Geological Map of Europe and Adjacent Areas (IGME5000)
[1] Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance des sols et à la résilience (directive sur la surveillance des sols) [COM(2023)0416 – C9-0234/2023 – 2023/0232(COD)
[2] Orientation générale du Conseil du 17 juin 2024 – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols)
[3] Correspond à une partie du territoire d’un État membre délimitée par celui-ci en application de la directive.
[4] Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat {SWD(2021) 323 final}, 17/11/2021, p.11 (lien)
[5] Stratégie pour la protection des sols (lien)
[6] Projet de directive relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols), 5 juin 2023, p. 11-12
[7] Résolutions du 28 avril 2021 sur la protection des sols [2021/2548(RSP)] et du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies [2020/2273 (INI)].
[8] Cour des comptes européenne (2018), Lutte contre la désertification dans l’UE : le phénomène s’aggravant, de nouvelles mesures s’imposent.
[9] Avis NAT-VII/010 du CdR lors de la séance plénière des 3, 4 et 5 février 2021 sur l’agroécologie et avis ENVE-VII/019 du CdR lors de la séance plénière des 26 et 27 janvier 2022 sur le plan d’action de l’Union : Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols.
[10] EEA Signals 2020 — Towards zero pollution in Europe - 15 Oct 2020- p.29
[11] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11299-2024-INIT/fr/pdf
[12] Surveillance des sols : accord avec le Conseil sur une nouvelle législation offrant un meilleur soutien aux agriculteurs, Parlement européen, ENVI, Communiqué de presse 10 avril 2025
[13] Directive sur la surveillance des sols : le Conseil parvient à un accord avec le Parlement, Conseil de l'Union européenne, Communiqué de presse, 10 avril 2025
[14] Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance des sols et à la résilience (directive sur la surveillance des sols) [COM(2023)0416 – C9-0234/2023 – 2023/0232(COD)]
[15] Orientation générale du Conseil du 17 juin 2024 – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols)
[16] Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols) déposé le 20 mars 2024, réalisé par la Commission au fond : Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI)