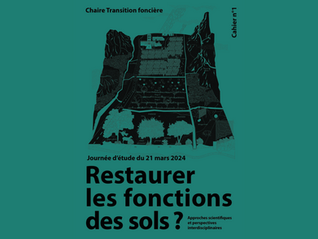Entretien avec Harold Levrel
- Institut de la Transition Foncière

- 28 mars 2024
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 oct. 2024
Harold Levrel est professeur à AgroParisTech, économiste écologique au sein du Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED). Il est coauteur de l’ouvrage L’économie face à la nature - De la prédation à la coévolution, paru en février 2023 (Les Petits matins).
Vous êtes économiste et travaillez dans le domaine de l’économie écologique, qui cherche à intégrer dans les modèles économiques les contraintes liées à l’environnement. Quel est l’intérêt de la transdisciplinarité pour aborder la transition ?
En économie, la transdisciplinarité permet d’obtenir une vision plus riche, plus adaptée au contexte et à l’histoire des territoires dans lesquels on applique des diagnostics. En parallèle de la perspective économique, cela veut dire faire appel au droit, à la sociologie, à l’écologie, par exemple. Avoir une perspective systémique des problèmes est nécessaire, car si on pense la transition uniquement en termes techniques, ça ne marchera pas, on ne parviendra pas à la mettre en œuvre.
Prenons l’exemple de l’agriculture. Si on pense que c’est simplement en renonçant aux produits phytosanitaires qu’on va réussir à convaincre, que c’est comme ça qu’on va opérer la transition, on se trompe. On doit prendre en compte le fait qu’il y a des organisations qui jouent un rôle clé dans cet écosystème, comme les syndicats, les chambres d’agriculture, les conseillers agricoles.
Du côté institutionnel c’est encore le remembrement qui domine, on continue de détruire des haies, des talus, pour créer des économies d’échelle. On sait pourtant aujourd’hui que c’est l’inverse dont on a besoin, puisque les petites parcelles permettent de protéger les cultures, plus vulnérables si on renonce aux produits phytosanitaires. Cela permet aussi de planter des arbres, de fournir un habitat pour la faune qui souffre de plus en plus de la sécheresse. On devrait aller vers la diversification à l’échelle locale : planter des légumineuses pour fixer le nitrate, coupler les cultures et l’élevage pour apporter des fertilisants organiques aux sols sans utiliser de l’amendement de synthèse, développer la culture de fourrage pour nourrir les bêtes… Les stratégies de polycultures-élevage font tout à fait sens.
C’est aussi le domaine juridique qu’il faut faire évoluer, puisque les règles qui sont édictées par les SAFER, la PAC, récompensent encore aujourd’hui le regroupement. Comme les primes de la PAC sont indexées principalement sur les surfaces, la stratégie gagnante pour un agriculteur c’est d’avoir toujours plus de surface pour toucher plus de primes, ce qui est incompatible avec la logique de la transition agro-écologique que je viens de décrire.
La dernière sphère, ce sont les systèmes de valeur. Tant qu’on considérera les agriculteurs comme des chefs d’entreprise qui gèrent des chaînes de production industrielle, ce sera difficile d’opérer la transition. La transition agroécologique repose au contraire sur une logique de complémentarité entre acteurs de la culture, de l’élevage, de la transformation, pour que chacun puisse récupérer une partie suffisante de la valeur, qui leur échappe pourtant aujourd’hui.
Toute transition est donc systémique, et c’est la raison pour laquelle le changement est très difficile à enclencher. Il faut comprendre qu’opérer la transition dans le domaine de l’agriculture, comme dans tout autre, cela veut dire bouleverser un système très cohérent, même si les conditions extérieures font qu’il est dans une impasse. Le monde agricole connaît une détresse humaine importante et il faut le prendre en compte. Non seulement les agriculteurs et les agricultrices sont coincés par des dettes associées à l’hyper-intensification, mais c’est aussi une population vieillissante - entre 25 et 50 % de la population agricole partira à la retraite d’ici 2030. Cela dit, on peut saisir l’opportunité de ce changement générationnel d'ici 2030, en imaginant des transitions plus ambitieuses. Encore faudrait-il que la puissance publique en prenne conscience, ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui en France.
J’ai pris l’exemple de l’agriculture, mais on aurait pu évoquer tout aussi bien celui de notre modèle de développement urbain, qui est aussi en crise aujourd’hui.

Il faut comprendre qu’opérer la transition dans le domaine de l’agriculture, comme dans tout autre, cela veut dire bouleverser un système très cohérent, même si les conditions extérieures font qu’il est dans une impasse.
Quelle est la spécificité de l’économie écologique de ce point de vue ?
L’économie écologique s’inscrit dans cette recherche d’une vision plus systémique des problèmes. D’un point de vue axiomatique c’est moins complet, plus mouvant, mais c’est aussi ce qui permet de ne pas rester figé dans un cadre qui parfois ne répond plus aux enjeux actuels. Aujourd’hui, l’économie de l’environnement standard manque une partie du sujet, parce qu’elle ne veut pas renouveler son outillage intellectuel. En raisonnant toujours en termes d’externalités par exemple, on reste sur une vision entièrement anthropocentrique, alors que le droit a donné un nouveau statut à la nature, avec des principes de protection, de compensation. Ce nouvel appareillage juridique peine à être appréhendé en économie avec les outils existants. Il faut donc sortir de sa zone de confort et renouveler les manières de faire.
Dans son approche de la compatibilité écologique, l’économie écologique s’intéresse ainsi à la dette écologique plutôt en termes de coûts, associés à des logiques d’équivalences biophysiques. Si on prend le préjudice écologique, ou l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, on essaie de calculer combien cela va coûter pour atteindre l’équivalence mentionnée dans la loi. On a donc un principe normatif, issu du droit et des sciences du vivant, qui s’impose au principe économique du maximum de bien-être, qui n’est plus très opérant dans ce cadre là. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu’il faut sacrifier le bien être à cet objectif écologique, mais que les outils classiques ne sont plus ceux qu’on doit utiliser.
On peut ainsi faire des diagnostics territoriaux en mobilisant des données et des connaissances issues d’autres disciplines. Les modèles que nous utilisons en économie écologique sont très plastiques, ce sont par exemple les systèmes multi-agents, qui peuvent représenter à la fois les stratégies individuelles, mais aussi les agents non humains. Dans ces modèles on peut aussi prendre en compte l’histoire, les spécificités culturelles, sociales, écologiques d’un territoire donné. Concrètement, la densification dans un territoire où les gens ont l’impression de manquer d’espaces verts sera plus facilement acceptée que dans un territoire où les habitants ont le sentiment d’une abondance de nature. C’est une approche co-évolutive, qui est de ne jamais faire l’impasse sur la diversité des situations.
Les échelles pertinentes de la modélisation, outre l’échelle locale, peuvent être les échelles biogéoclimatique ou sectorielle. C’est aussi la notion de ressource commune qui est importante ici, dans le choix de la bonne échelle de modélisation. A l’échelle locale, les acteurs ont beaucoup plus le sentiment d’avoir une ressource commune qu’ils partagent, et vis à vis de laquelle ils ont une certaine responsabilité. A une échelle plus large, les choses sont plus désincarnées. L’entrée sectorielle est aussi intéressante pour créer du dialogue avec les acteurs qui travaillent sur ces questions de transition, parce qu’un secteur génère des effets assez homogènes, avec des modèles économiques, des impacts et des responsabilités similaires.
C’est aussi la notion de ressource commune qui est importante ici, dans le choix de la bonne échelle de modélisation. A l’échelle locale, les acteurs ont beaucoup plus le sentiment d’avoir une ressource commune qu’ils partagent, et vis à vis de laquelle ils ont une certaine responsabilité. A une échelle plus large, les choses sont plus désincarnées.
Comment peut-on prendre en compte les sols dans la comptabilité écologique ?
On traitera les choses de manière différente dans le cadre de l’aménagement et de l’agriculture. Dans le domaine de l’aménagement, on peut s’appuyer sur des normes qui contraignent aujourd’hui le secteur de la construction, comme le ZAN, le principe d’absence de perte nette de biodiversité que j’ai mentionné tout à l’heure. Pour l’instant, la loi biodiversité de 2016 n’est pas respectée. Les dérogations au titre des espèces menacées et des zones humides sont obtenues sans qu’il y ait d’équivalences réelles, et on laisse de côté tout ce qui concerne l’impact de la biodiversité ordinaire. Mais on a tout de même à disposition une assise réglementaire pour agir pour la protection des sols non bâtis.
Dans le monde agricole c’est différent, il n’y a pas d’assise institutionnelle spécifique. On est obligé de s’appuyer sur d’autres leviers. L’enjeu ne porte pas sur les surfaces non bâties mais la qualité des sols, et comment ces sols peuvent fournir les bases d’une chaîne trophique qui fonctionne. On voit d’ailleurs qu’elle ne fonctionne plus aujourd’hui, on observe un effondrement des oiseaux associés au monde agricole (36% d’individus en moins entre 1989 et 2021). Les sols agricoles ne fonctionnent plus pour produire comme il faudrait les bases de la chaîne alimentaire.

On continue de découvrir aujourd’hui toute la complexité du fonctionnement des écosystèmes et des cycles biogéoclimatiques. Si on prend l’exemple des sols, une grande part d’inconnu subsiste. Comment dans ce contexte l’économie peut-elle trouver sa place vis-à-vis des sciences naturelles ?
L’économie de l’environnement classique va essayer de mobiliser des outils d’évaluation économique de la nature, pour la faire rentrer dans des mécanismes économiques. Ce n’est pas inutile et ça peut même être très utile si c’est bien fait. Mais c’est insuffisant, parce que ça ne garantit pas qu’en payant pour ça on va respecter les limites planétaires, assurer le renouvellement de la fertilité des sols ou que les pollinisateurs ne vont pas disparaître. En économie écologique on prend en compte un ensemble de connaissances en écologie scientifique, sur les limites dans lesquelles le système économique doit être ré-encastré. Cela s’applique à la fois au champ théorique, mais aussi à l’économie réelle. L’objectif est de pouvoir fixer des limites physiques à des secteurs d’activité, d’où l’intérêt de l’approche sectorielle que j’évoquais tout à l’heure. Il revient ensuite à chaque secteur la responsabilité de répartir ces limites entre les entreprises.
La puissance publique devrait aussi mobiliser ces nouveaux outils, elle devrait pouvoir raisonner sur la base d’éléments biogéoclimatiques, en prenant l’économie comme un instrument, non pas comme une fin. Le problème c’est que c’est l’inverse qui est fait aujourd’hui. L’économie ce n’est pas un bloc scientifique univoque, c’est à la fois une science, une somme de secteurs d’activités, qui garantissent une richesse et un renouvellement matériel dans une société donnée. Ce sont aussi des outils qui sont à disposition de l’Etat pour agir sur les acteurs qui font les dynamiques.