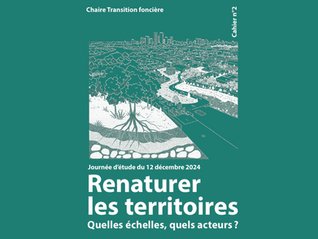Connaître la qualité des sols pour mieux les préserver : un diagnostic au moment des ventes ?
- Institut de la Transition Foncière

- 3 juin 2025
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 4 sept. 2025
Avant propos
Les sols. Exister, c’est, littéralement, se tenir hors d’eux – ex sistere. Est-ce pour cette raison que nous, citoyens, le connaissons si mal ? Si la France a la chance d’avoir une communauté de scientifiques qui a poussé loin la recherche sur les sols et permis des avancées pionnières, comme le Réseau de mesure de la qualité des sols (RMQS) et l’établissement des Référentiels Régionaux Pédologiques (RRP), l’immense majorité d’entre nous, cependant, ignore l’état des sols sous ses pieds. Les acteurs des politiques publiques, comme les entreprises qui construisent et aménagent, n’échappent pas à la règle.
Il est pourtant urgent de disposer de cette connaissance, partout où c’est possible. L’information sur les sols, c’est à dire sur l’état de leurs fonctions, est indispensable à la politique foncière et au Zéro artificialisation nette; indispensable à l’élaboration d’une politique agricole et alimentaire locale (Plans alimentaires territoriaux, etc.); indispensable à l’atténuation du changement climatique (pour maintenir ou améliorer la séquestration du carbone et de la matière organique); indispensable à l’anticipation et la gestion des risques naturels; indispensable à la préservation et la restauration du cycle de l’eau; indispensable, enfin, à l’adaptation aux conséquences du réchauffement.
Des collectivités, pionnières, ont montré la voie : Rouen, Ris-Orangis… en engageant des investigations inédites : atlas et cartographies fines, et parfois sondages sur terrains publics et privés. Elles sont ainsi beaucoup mieux préparées et outillées pour une gestion durable de leur territoire : urbanisme, protection et résilience vis-à-vis des catastrophes naturelles, accès à la nature, sécurité alimentaire et santé environnementale, eau… Toutefois, ces démarches demeurent des exceptions, ayant souvent mobilisé des fonds eux-mêmes exceptionnels (AMI Ademe, appels à projets…). De même, des propositions législatives ont émergé à l’ Assemblée (R. Ramos) comme au Sénat (N. Bonnefoy), sans être adoptées jusqu’à présent.
Il était donc urgent d’éclairer la possibilité, concrète, d’obtenir une connaissance des sols à l’échelle cadastrale, celle de la parcelle, aussi précise, en somme, que la connaissance foncière. C’est la raison pour laquelle l’Institut de la Transition foncière a entrepris cet ambitieux travail d’étude de la faisabilité d’un Diagnostic Sols dans les cessions foncières et immobilières, avec le soutien précieux de l’Office français de la Biodiversité et de l’ Ademe, ainsi que de nombreux experts. Nous espérons que ce travail démontre qu’il est non seulement urgent, mais aussi possible d’agir, pour que, en matière de sols comme de carbone et d’eau, l’exception… devienne la règle.
Jean Guiony
Urbaniste
Président de l’Institut de la transition foncière
Membre du Conseil national de l’habitat
L'intégralité de l'étude est disponible ici :