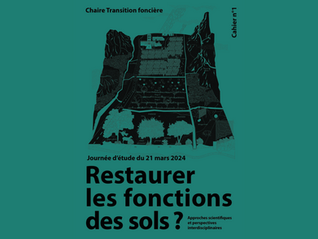Cahier d'acteur - Contribution au PNACC
- Institut de la Transition Foncière

- 23 janv.
- 10 min de lecture
Dernière mise à jour : 18 sept.
Dans un contexte de hausse possible des températures moyennes en France de +4 °C d’ici la fin du siècle, l’adaptation au changement climatique est une nécessité, sans freiner les efforts d’atténuation du changement climatique avec la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le développement du potentiel de séquestration de carbone dans les puits naturels. Pour répondre à cette hausse attendue, le troisième Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC3) propose une stratégie articulée autour de 51 mesures et cinq objectifs : protéger la population, renforcer la résilience des territoires, préserver les patrimoines naturels et culturels, et mobiliser la société. Fondé sur des principes d’anticipation et de différenciation locale, le PNACC3 envisage notamment une planification publique intégrant la Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l’Adaptation au Changement Climatique (TRACC) dans les documents et stratégies territoriales. Une consultation nationale - sectorielle et grand public - et territoriale a accompagné cette démarche pour engager l’ensemble des acteurs.
Dans cette contribution, nous soulignons une présence insuffisante des sols dans le PNACC relativement à l’importance que ces derniers sont appelés à jouer dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.
Nous constatons en effet une faible considération des fonctions des sols dans les stratégies d’adaptation. Pourtant, les sols sont le principal réservoir de stockage de carbone de l’atmosphère, et donc la principale solution pour atténuer le changement climatique ; il existe par ailleurs une grande dépendance entre l’adaptation de notre capacité productive alimentaire et les sols qui en supportent 95% de celle-ci. Enfin, à l’heure où le sixième rapport du GIEC estime une augmentation des précipitations extrêmes de 7 % pour chaque degré d’augmentation de température, exacerbant les inondations par ruissellement, les sols devraient être saisis comme levier central de la régulation du cycle de l’eau. Pourtant, plus de 60% des sols sont dégradés par de multiples activités humaines : urbanisation, mobilité, extraction, agriculture etc.
Nous relevons par ailleurs les manques suivants : l’absence d'un pilier dédié à la formation sur les sols vivants et leurs fonctions permettant la mobilisation de tous (Axe 5) ; l’absence de prise en compte de l’empreinte sur les sols des organisations dans les différentes mesures sur leur vulnérabilité (Axe 3) ; enfin, support de nos habitats et infrastructures, le sol est au coeur des risques environnementaux que le système assurantiel doit anticiper sans pour autant figurer au centre des stratégies qui visent ces dernières (Axe 1).
Ce cahier d’acteur vise à décrire les mesures du PNACC prenant en compte directement ou indirectement les sols et à proposer des compléments pour mieux les intégrer.
Les sols en filigrane de plusieurs mesures, parfois avec une prise en compte limitée de leurs multifonctionnalités
Le PNACC3 vise les sols à travers plusieurs mesures permettant de restaurer certaines de leurs fonctionnalités écologiques et à renforcer leur rôle dans l’adaptation au changement climatique. Le PNACC aborde aussi bien les sols urbains, que agricoles, forestiers et littoraux. Toutefois, chacune des 4 fonctionnalités (biologique, hydrique, climatique, agronomique) n’est pas toujours prise en compte dans les mesures.
En premier lieu, la mesure 13 prévoit la massification des opérations de renaturation en milieu urbain pour réduire les îlots de chaleur et accroître la résilience des villes. La renaturation est définie dans la fiche de la mesure 13 comme “recréation ou amélioration des fonctionnalités écologiques” des sols et des milieux. Cette mesure repose sur des outils comme le soutien financier via le Fonds vert et la promotion d’un urbanisme bioclimatique. Il est prévu, avec l’action 4 de la mesure 13, d’accompagner la montée en compétences de la filière de la renaturation, fondée sur un état des lieux puis des formations. Il serait souhaitable d’accompagner ces formations d’un référentiel des techniques de renaturation et de leur évaluation, afin d’assurer la pertinence des opérations de renaturation pour la multifonctionnalité.
Proposition 1 : soutenir et diffuser largement le Référentiel des techniques de renaturation porté par l’Institut de la Transition foncière, soutenu par l’ADEME avec Arp-Astrance et Icade.
La mesure 37 met l’accent sur les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) comme levier clé de l’adaptation au changement climatique entre 2024 et 2026, en particulier pour la lutte contre l’érosion et la salinisation des sols et pour le maintien de leur fertilité. Ces mécanismes favorisent l’infiltration de l’eau dans les sols, renforçant ainsi leur rôle dans l’adaptation des exploitations agricoles. Toutefois, pour être pleinement pilotable, cette mesure pourrait s’appuyer sur une meilleure connaissance des sols et de leurs quatre fonctions, à travers, par exemple, la mise en place d’un diagnostic sol dans les transactions foncières. La connaissance de l’état des sols est aujourd’hui limitée, puisqu’à une échelle 1/250 000, bien loin de la plupart des politiques publiques dont l’échelle est le plus souvent limitée à la parcelle.
Proposition 2 : établir les conditions de faisabilité d’un diagnostic sol, sur les 4 fonctions citées dans la loi climat et résilience, dans les transactions foncières et étudier les politiques publiques pouvant en découler. [Ce diagnostic permettrait de bénéficier d’une donnée harmonisée, en France, à l’échelle de la parcelle, c'est-à-dire à l’échelle de la planification urbaine et des projets.]
La mesure 38, centrée sur l’adaptation de la filière bois et les impacts du changement climatique sur l’exploitation du bois, pourrait inclure des lignes directrices pour préserver la biodiversité des sols forestiers - au-delà de l’atteinte aux fonctions hydriques et au service de portage du sol mentionnés dans cette mesure. [En effet, les forêts sont actuellement surestimées comme puits de carbone dans les stratégies nationales d’atténuation, à l’inverse des différentes fonctions des sols forestiers en termes de séquestration carbone et de support de biodiversité.] [1]
Proposition 3 : intégrer le maintien et le développement de la biodiversité, [ainsi qu’un volet capacité de séquestration de carbone], des sols forestiers dans les objectifs de la mesure 38.
Concernant le dernier objectif du PNACC, “mobiliser la société”, l’Institut plaide pour la mise en œuvre, au niveau local comme national, de politiques actives visant à mobiliser les propriétaires fonciers, et donc concrètement les ménages et personnes qui les composent, dans le but de mieux connaître leurs sols, leurs qualités, et les inciter à entretenir ces fonctions écologiques voire les restaurer. Il est crucial de développer une meilleure connaissance citoyenne des sols et de leur rôle, ainsi qu’une responsabilité citoyenne vis-à-vis de leur protection afin que tous puissent contribuer à la multifonctionnalité des sols et donc, à l’adaptation au changement climatique, en même temps qu’au ralentissement de l’effondrement de la biodiversité. Les politiques de tri et de collecte des déchets peuvent constituer une bonne source d’inspiration pour la communication et l’engagement citoyen.
Proposition 4 : Mettre à la disposition de tous les ménages une communication écrite les invitant à participer aux objectifs de préservation des sols naturels dans une logique de contribution à la transition et de préservation de leurs patrimoine naturel local, mais également de préservation des ressources (eau notamment). Elle pourrait comprendre utilement : 1/ Des éléments aidant à l'identification des éléments de l’espace naturel que le ménage possède : prairie, zone humide, haies bocagères, etc ; 2/ Les principales fonctions écologiques remplies par les sols et par les différents types d’espaces naturels ; 3/ Les conseils pratiques visant à préserver ces fonctions et à éviter leur bétonisation - notamment vis à vis des activités de jardinage, maraîchage personnel, activités artisanales, activités sportives, qui pourraient être pratiquées sur le site ; 4/ Les conseils pratiques visant à restaurer ces fonctions
Intégrer les sols comme cadre d’analyse de l’adaptation et améliorer leur connaissance
Les sols ont tout intérêt à être intégrés comme cadre transversal d’analyse et de décision dans les documents réglementaires sur l’adaptation au changement climatique comme sur le respect des écosystèmes. Intégrer les sols comme milieu et habitat à part entière, ayant plusieurs fonctions écosystémiques, permet de tisser des liens entre les îlots de chaleurs urbains, les impacts négatifs d’un modèle agricole intensif, le retraits-gonflements des argiles, ou encore l’adaptation des forêts, différents points mentionnés dans le PNACC.
Ces mesures visent aussi à créer des indicateurs et des bases de données, qui pourraient permettre la visualisation de l’impact sur les sols et des fonctions des sols. Par exemple, la mesure 5 porte sur le retrait-gonflement des argiles (RGA) et soumet l’idée d’un label volontaire acquis par les propriétaires afin de créer de l’information sur le risque de RGA. Ce label pourrait être enrichi par un label volontaire destiné à améliorer la connaissance de toutes les fonctions écologiques des sols, en élargissant l’approche à d’autres types de sols vulnérables, puisque la fonction absorption hydrique peut réduire le risque d’inondation, ou la fonction de support de biodiversité et de captation carbone le risque d'îlot de chaleur. Ces nouvelles connaissances pourraient venir nourrir une base de données nationale sur l’état des sols, en lien avec l’éventuelle mise en place d’un diagnostic sol dans les transactions foncières (voir proposition 2).
Proposition 5 : Contribuer à la connaissance des sols et de leur fonctionnalité en élargissant le label volontaire sur le RGA aux autres fonctions des sols.
La mesure 22, qui propose un portail national des impacts, gagnerait par exemple à inclure un volet de calcul de l’empreinte foncière des activités, pour sensibiliser aux impacts des usages des sols. Il s’agirait de mesurer l’impact non seulement surfacique mais également en volume, et l’impact des activités non seulement sur les emprises foncières des activités humaines, mais aussi en dehors de cette emprise (pour l’extraction de matériaux par exemple). Cette nouvelle métrique permettrait de piloter les activités vers une moindre empreinte foncière, donc une meilleure fonctionnalité des sols, et donc une meilleure résilience au changement climatique.
Proposition 6 : développer une méthode de calcul de l’empreinte foncière des activités, et intégrer son suivi au portail national des impacts
La mesure 26, qui prévoit une liste d’indicateurs pour évaluer les progrès locaux en matière d’adaptation, pourrait inclure, entre autres critères clé, une évaluation des fonctions des sols via un diagnostic, pour mieux planifier leur utilisation ainsi que pour évaluer l’évolution de leur résilience. Ce diagnostic pourrait être suivi par la mise en place d’une plateforme nationale dédiée au diagnostic rapide de la vulnérabilité des sols et aiderait les collectivités à identifier les mesures de restauration prioritaires (voir proposition 2).
La mesure 27, consacrée aux financements publics en faveur de la transition écologique, devrait généraliser l’utilisation de mécanismes économiques incitatifs, tels que les PSE, pour valoriser les externalités positives liées à la préservation des sols tout en dissuadant les pratiques néfastes comme l’Institut le défend dans le Bilan de transition foncière (voir proposition 4). Une généralisation des PSE permettrait par ailleurs d’accélérer les projets de renaturation et de restauration.
[Enfin, la mesure 25 qui plaide pour la mise en place d’un guichet unique d’ingénierie de l’adaptation à destination des collectivités locales devrait intégrer une offre de formation en lien avec l’offre d'ingénierie, et notamment sur les sols dont les enjeux sont souvent méconnus et invisibilisés. La mesure 36 complète par ailleurs cette ambition puisqu’elle souhaite favoriser une meilleure connaissances et former le secteur agricole et l’industrie agro-alimentaire sur les conséquences du changement climatique, certainement en faisant le lien entre pratiques et états des sols. La formation, sur cette nouvelle frontière de la transition écologique que constituent les sols, doit constituer un pilier structurant de l’une stratégie d’adaptation.
Proposition 7 : assurer auprès des différents secteurs d’activités et des agents publics territoriaux une formation sur les sols vivants, leur fonctions et leur préservation.]
Doter les acteurs des outils manquants pour l’adaptation au changement climatique par la multifonctionnalité des sols
Tout au long du PNACC, quelques outils – financiers comme le fonds vert ou les PSE, de connaissance comme le label mentionné à la mesure 5 – sont proposés pour accompagner les acteurs dans la mise en œuvre des mesures. Cette démarche d’outillage pourrait être renforcée, notamment pour les outils relatifs au financement et au modèle économique des actions d’adaptation par la multifonctionnalité des sols.
Par exemple, la prise en compte des sols littoraux est prévue par la mesure 4, qui propose des solutions fondées sur la nature pour préserver les zones côtières face au recul du trait de côte, notamment grâce à des plans de gestion intégrée et de renaturation. Cette mesure pourrait être complétée par la conception de modèles économiques de portage foncier viables afin d’accompagner la renaturation des sols littoraux, leur dépollution, ou simplement leur gestion foncière. En effet, ces espaces sont souvent des zones naturelles agricoles ou forestières, ou bien des zones qui sont vouées à la désurbanisation, dans un contexte où tout portage foncier se fonde sur la perspective de la transformation du foncier vers l’urbanisation.
Dans cet esprit, l’action 5 vise à accompagner les collectivités littorales dans l’établissement de recompositions spatiales. Toutefois, les outils à disposition des collectivités pour leurs stratégies foncières (portage, maîtrise, gestion) restent mal connus et opaques. En particulier, il serait utile de mettre à disposition un guide sur les modalités de portage, maîtrise et gestion foncière des espaces naturels non bâtis afin de les préserver et d’améliorer leur fonctionnalité.
Proposition 8 : Inciter au développement, par les collectivités ou avec leur soutien et leur contrôle, des solutions de maîtrise et de portage des fonciers naturels, agricoles et forestiers à long-terme, fondé sur des modèles économiques sans transformation immobilière. Appuyer la réalisation d'un Guide à destination des collectivités.
L’action 7 de la mesure 4 vise à définir un modèle économique soutenable de l’adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte. Outre l’étude des modalités existantes de portage et de maîtrise et leurs modèles économiques associés, il serait utile de soutenir le développement d’outils de réforme du modèle économique de l’aménagement actuellement en développement. En particulier, l’outil bilan de transition foncière propose d’intégrer au bilan des opérations d’aménagement les coûts de renaturation future des parcelles bâties et donc de visibiliser la destruction des fonctionnalités des sols dans le modèle économique des opérations. Il favorise donc les opérations préservant les sols et leurs fonctionnalités, dont celle de rétention des eaux.
Proposition 9 : Introduire un principe de bonus-malus dans les modèles économiques de l’aménagement en fonction de l’impact sur les fonctions des sols. [L’octroi de subventions à des projets d’aménagement pourrait notamment être conditionné à la production d’un bilan d’opération qui objective la dette écologique de l’artificialisation et, au contraire, la dette évitée par des pratiques de sobriété foncière ainsi que la dette réduite par les actions de renaturation. Ce bilan permettrait ainsi de visibiliser les charges cachées mais aussi de nouvelles recettes, certaines en provenance des finances publiques, d’autres du marché (opérateurs de compensation par exemple). Ce modèle de bilan est actuellement en expérimentation par l’Institut de la transition foncière avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), L’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France (AORIF) et la ville de Montbrison.]
Conclusion
L’institut de la Transition foncière suggère donc d’intégrer plus largement les sols comme grille d’analyse des politiques de transition et d’adaptation au même titre que l’eau, le carbone ou la biodiversité. Par ailleurs, la promotion d’une vision systémique des sols, intégrant ses fonctions et potentiels agronomique, biologique, hydrique et climatique, doit être soutenue par une visibilité accrue des impacts négatifs sur les sols : le développement d’outils numériques intégrant des données climatiques, hydrologiques et biogéochimiques pourrait accompagner une meilleure gestion des sols agricoles, forestiers et urbains.
Les voies indiquées dans le PNACC telles que l’utilisation de la Recherche et développement, la valorisation des externalités positives et négatives dans de nouveaux modèles économiques, ou encore l’outillage des territoires sont celles portées dans l’ADN de l’Institut, dont les propositions ci-dessus témoignent.

[1] Les phrases entre crochets constituent des ajouts par rapport à la contribution déposée officiellement à la concertation en décembre.